
Nous passons un tiers de notre vie à dormir, et un douzième à rêver.
Sur une vie de 90 ans, cela représente 7 années passées au pays des songes, un monde bien énigmatique et mystérieux qui ne laisse personne indifférent.
Des traces des premiers rêveurs retrouvées sur les parois des cavernes en Australie il y a de cela 19000 ans aux récentes découvertes scientifiques surprenantes, en passant par les rêves lucides, les rêves « visite » et prémonitoires, je vous propose un voyage pas comme les autres au sein d’un univers qui fascine l’humanité depuis la nuit des temps.
Nous allons aussi nous frotter à l’interprétation des rêves, qui, si elle est parfois bien utile pour la découverte de soi, se doit de rester prudente. Ce cher Freud viendra bien évidemment teinter cet article haut en couleurs.
Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par la magie des rêves.
Pour rédiger ce chapitre, je me suis inspirée de la conférence « Le rêve, passage entre deux monde » organisée par le Réseau Morphée à l’occasion de la 22ème édition de la Journée Internationale du Sommeil. Le Docteur Sarah Hartley y fait une superbe intervention au sujet des rêves et de leur histoire à travers l’humanité.
L’histoire des rêves est très ancienne puisque l’on retrouve déjà des figures oniriques dans l’art rupestre datant de 17000 avant J.-C.
C’est précisément en Australie que la plus ancienne œuvre d’art semblant représenter un rêve a été découverte par une équipe d’archéologues. On peut y apercevoir une personne allongée sur le dos, aux cheveux tressés et entourée de taches de couleurs et d’un tout petit individu qui semble courir dans l’air au-dessus d’elle. Il y a fort à penser que les peuples aborigènes dotaient déjà les rêves d’une dimension particulière, au point d’en laisser des traces sur les parois des cavernes qui les abritaient.
Pour explorer les rêves de façon un peu plus détaillée, il faut visiter la Mésopotamie à l’aube de l’écriture et se plonger dans l’histoire de Gilgamesh, en 3700 avant J.-C. Les aventures de Gilgamesh, le premier héros de l’humanité, y sont relatées sur des tablettes d’argile sumériennes en écriture cunéiforme. On peut y lire toutes ses péripéties mais surtout ses rêves, considérés comme des messages des dieux auxquels il devait obéir.
L’histoire des civilisations nous apprend que les rêves ont longtemps renfermé une dimension métaphysique. Perçus comme un voyage, un moyen d’accéder au surnaturel, au divin ou aux ancêtres, les songes étaient de véritables portes ouvertes sur un ailleurs apportant une forme de clairvoyance, de connaissance et même la guérison.
En 2500 av J.-C, les Egyptiens considéraient que les rêves étaient une façon privilégiée de communiquer avec les dieux. Cette communication était si importante que des lits de rêves avaient été érigés dans les temples. C’est aussi à cette époque que l’on découvre les premiers manuels d’interprétation dont le célèbre Dream Book, datant de 1200 avant J.-C et qui se trouve actuellement dans la sublime collection du British Museum.
Les Grecs accordaient eux aussi une grande importance aux rêves, considérés bien plus comme des visions que des produits de leur imagination. D’ailleurs, quand un grec rêvait, il ne disait pas « J’ai fait un rêve », mais « J’ai vu un rêve ». Parmi les devins professionnels de l’époque, il y a eu le célèbre Artémidore de Daldis, écrivain et philosophe du 2ème siècle après J.-C qui a recueilli de nombreux récits de rêves lors de ses voyages. Son ouvrage principal, l’Orneirokriticon (littéralement « interprétation des rêves »), servira durant des siècles d’ouvrage de référence sur la question.
Chez les Romains, certains rêves étaient soumis au Sénat afin d’être analysés et interprétés en vue d’actions politiques. On y pratiquait aussi l’incubation. Il s’agissait d’aller dormir dans des temples ou des grottes pour se soigner de maladies.
Au Moyen-âge, c’est la Bible qui tient une place centrale dans l’interprétation des rêves. L’oniromancie, considérée comme une forme de sorcellerie, est même officiellement proscrite à partir du 7ème siècle. L’une des raisons qui ont poussé des générations entières de moines à veiller aux heures précoces du jour était d’éviter les rêves, non contrôlés par la volonté et parfois impurs ou envoyés par le démon.
Au 16ème et 17ème siècles, les rêves sont vus comme l’œuvre du démon et ceux qui interprétaient les rêves étaient assassinés.
Au 18ème siècle, la rationalité s’impose et le songe devient un phénomène secondaire. Cette vision plus cartésienne a laissé une certaine empreinte dans nos sociétés occidentales.
Les Corses résistent en conservant jalousement la dernière culture chamanique d’Occident. Il subsiste encore sur l’île de Beauté quelques grands-mères qui pour rien au monde ne fermeraient la fenêtre pendant que leur petit-enfant dort, car son âme, partant en vadrouille pendant un songe, risquerait de ne pas pouvoir réintégrer son corps !
Au 20ème siècle, les théories psychanalytiques freudiennes ont réintroduit la question du rêve en le considérant comme une des manifestations de notre inconscient. Elles ont créé un courant si puissant que leur influence prédomine encore aujourd’hui.
Freud a permis une avancée scientifique majeure en situant les rêves dans le cerveau. Cela nous semble une évidence aujourd’hui, mais ça n’était pas le cas à l’époque.
Dans son ouvrage majeur « L’interprétation des rêves » (1900), Freud, inspiré par ses propres rêves, défend l’hypothèse que les rêves naissent de désirs non assouvis si puissants et bouleversants qu’ils sont obligés de passer par une forme de censure effectuée par le psychisme. Cette dernière s’appelle le refoulement.
Si ce filtre n’opère pas, le dormeur peut être réveillé et particulièrement perturbé par le contenu de ses rêves, d’où l’adage de ce cher Sigmund : « Le rêve est le gardien du sommeil ». Le dormeur peut ainsi satisfaire ses désirs les plus inavoués sans en être inquiété.
Le rêve selon Freud protège également le sommeil en intégrant les stimulations extérieures, comme des sons. Ne vous est-il jamais arrivé d’inclure la sonnerie de votre réveil dans l’un de vos rêves et de ne pas vous réveiller ? Cette mésaventure, je l’ai vécue plus d’une fois !
Si le produit de notre inconscient se cache derrière les rêves, comment dès lors accéder à leur signification ? Grâce à une interprétation psychanalytique, tout un art à l’époque.
Seul un psychanalyste averti pouvait déchiffrer et analyser le contenu latent (caché) de l’univers onirique et en dévoiler le contenu manifeste, c’est-à-dire la véritable signification.
Cette interprétation présentait toutefois ses limites car elle était particulièrement subjective et donc facile à généraliser. On pourrait comparer cela à la lecture d’un horoscope. De plus, elle ne reposait sur aucune méthode scientifique fiable. Cependant, l’influence de Freud a été colossale et perdure dans le domaine de la recherche sur les rêves car les scientifiques n’ont jamais pu contredire formellement ses théories.
Depuis les années 2000, grâce au développement de l’imagerie résonance magnétique (IRM), l’activité cérébrale onirique est analysée plus en profondeur et même visualisée en trois dimensions.
Les neurobiologistes ont fait des découvertes surprenantes : les rêves ne seraient pas que de simples « hallucinations nocturnes », mais de véritables moteurs de créativité, d’évolution, d’apprentissage et de guérison émotionnelle.
En 1928, la découverte de l’électroencéphalographie (EEG) a permis d’étudier l’activité électrique cérébrale. La correspondance entre rêve et cerveau, qui n’était alors qu’une hypothèse, devint une évidence.
À partir des années 1950, la neurophysiologie des rêves voit véritablement le jour et le terme « sommeil paradoxal » apparait.
On le doit à Michel Jouvet, neurobiologiste français, onirologue et pionnier de l’hypnologie, qui l’a mis en évidence lorsqu’il a découvert les différents stades du sommeil.
Si vous désirez en savoir plus sur les phases du sommeil, je vous invite à aller consulter cet article qui explique en détail ce qu’est le sommeil proprement dit.
Le sommeil paradoxal est à proprement parler celui des rêves, du moins ceux qui sont les plus vifs et riches en images.
Il est qualifié de paradoxal car l’activité cérébrale est proche de celle de l’éveil, tandis que nous sommes incapables de bouger. Le tonus musculaire disparait totalement à l’exception des mouvements oculaires qui sont très rapides. Voilà pourquoi on l’appelle aussi sommeil « REM », pour « Rapid Eye Movements ».
Nous sommes totalement paralysés car notre cerveau sécrète des neurotransmetteurs qui interrompent la liaison entre le cerveau et les muscles. Cette paralysie, appelée « atonie », n’est pas due au hasard. Elle est une sécurité qui nous empêche de mettre nos rêves en action. Imaginez la catastrophe si vous bougiez comme dans vos rêves, tandis que vous êtes incapables de percevoir ce qui vous entoure !
Le sommeil paradoxal apparaît majoritairement en milieu et fin de nuit, ce qui permet notamment un réveil plus en douceur car l’activité cérébrale y est proche de celle de la veille.
Les dernières avancées scientifiques démontrent que les rêves auraient une utilité pour l’être humain.
Considérés comme une activité cognitive à part entière, ils nous permettraient de mieux apprendre.
Les neurobiologistes ont découvert que le sommeil REM est caractérisé par une forte activité cérébrale dans les régions des mémoires visuelle, gustative, olfactive, motrice, émotionnelle et autobiographique. Dans le même temps, et c’est ce qui explique l’étrangeté et l’incohérence des rêves, les régions cérébrales impliquées dans la rationalisation sont désactivées (le cortex préfrontal).
Lorsque nous rêvons, nous semblons opérer une véritable révision de tous les savoirs que nous avons acquis. Ces derniers sont triés et catégorisés afin que nous ayons accès à l’essentiel. Au réveil, nous parvenons à y voir plus clair.
Notre mémoire s’ouvre ainsi à des concepts beaucoup plus abstraits et éloignés, comme si nous regardions à l’autre bout d’un télescope. Il ne s’agit donc pas que d’apprentissage, mais d’une véritable compréhension en profondeur.
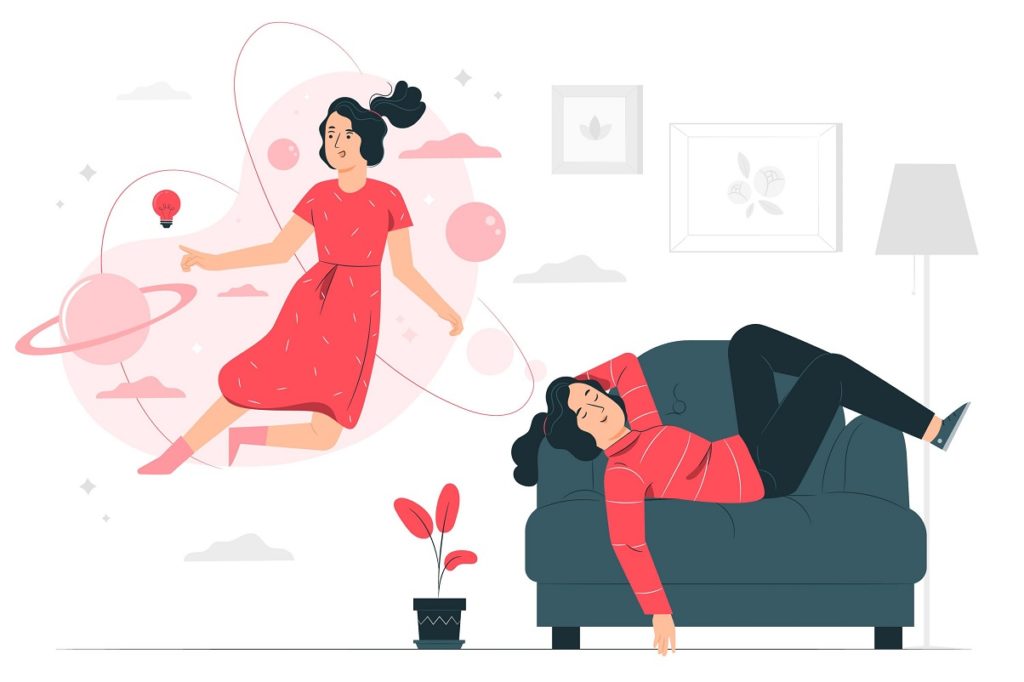
En nous faisant vivre ou revivre des situations particulières, les rêves nous aideraient à trouver des solutions afin de résoudre des difficultés et de mieux nous adapter à certaines menaces.
On peut par exemple rêver qu’on arrive en retard au travail ou à un examen, rater une épreuve qu’on avait pourtant réussie. Ceci est tout à fait coutumier et même bénéfique : on revit des catastrophes ou on s’entraine à en vivre afin d’y être préparé si elles finissent par survenir.
L’activité onirique, en plus de nous permettre de prendre une certaine distance par rapport à nos vécus et de nous préparer au pire, nous donnerait également des idées, et de génie pour certains.
Certains savants comme Singer, l’inventeur de la machine à coudre, auraient trouvé la solution à leurs problèmes en rêvant ! Plus récemment, on raconte que des chansons mythiques comme « Yesterday » et « Let it be » seraient issues des rêves de Paul McCartney. Le célèbre riff de « (I can’t get no) Satisfaction » des Rollings Stones serait apparu dans le rêve de Keith Richards. Mendeleïv, quant à lui, aurait finalisé son tableau lors d’un rêve. Enfin, Einstein aurait rêvé de la théorie de la relativité.
Faut-il encore des preuves pour vous convaincre que la nuit porte conseil ?
Les émotions font partie prenante des rêves. Nous ressentons de la joie, de la colère, de la tristesse, de la peur.
Il n’y a pas de censure, pas d’éléments cachés, à l’inverse de ce que Freud pensait. Toutes ces émotions sont présentes afin de pouvoir être déchargées et mieux régulées.
Selon le Dr Walker « Ce n’est peut-être pas le temps qui guérit les blessures, mais le temps que l’on passe à rêver (…) Les rêves effacent les blessures douloureuses suivant les épisodes émotionnels désagréables, voire traumatisants, vécus pendant la journée, offrant ainsi un pansement émotionnel au réveil » (issu du brillant ouvrage « Pourquoi nous dormons ? »; pp. 328-329).
Cette théorie se fonde sur un changement qui se produit au niveau de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Plus particulièrement, la noradrénaline, substance associée au stress.
La noradrénaline est totalement absente dans la phase du sommeil paradoxal. C’est d’ailleurs le seul moment de la journée où cette molécule est inexistante dans notre cerveau. C’est par conséquent le moment le plus opportun où le souvenir d’évènements difficiles voire traumatiques peut être ravivé, car il le sera librement sans être associé aux émotions stressantes auxquelles ces évènements étaient liés.
Rêver guérirait ainsi nos blessures émotionnelles.
Ce n’est malheureusement pas toujours le cas, et notamment dans le trouble de stress post-traumatique (TSPT).
Cette pathologie psychiatrique est caractérisée, entre autres, par des flashbacks de souvenirs terrifiants associés à des cauchemars fréquents. Elle a été découverte chez des vétérans qui ne parvenaient pas à se remettre d’horreurs vécues pendant la guerre. Elle est généralisée à présent à toute personne ayant été victime (ou témoin) d’épisodes traumatisants qu’elle ne peut intégrer dans le cours de sa vie.
De fait, chez les personnes souffrant du TSPT, l’émotion reste vivement associée au souvenir traumatique. Des études récentes ont mis en évidence que le sommeil REM est perturbé chez les personnes souffrant de cette pathologie. Plus précisément, leur système nerveux sécrèterait plus de noradrénaline.
Un sommeil paradoxal de meilleure qualité permettrait une compréhension supérieure du monde social.
Il a été découvert notamment que des sujets manquant de sommeil REM ont tendance à percevoir le monde extérieur comme plus menaçant et à perdre leur discernement.
Le sommeil paradoxal régulerait également nos émotions, nous offrant la possibilité d’être plus réfléchis, moins impulsifs.
Toutes ces caractéristiques amènent les scientifiques à avancer que le sommeil paradoxal aurait été un facteur déterminant dans l’évolution de l’espèce humaine.
Bien entendu !
Bien qu’il existe quelques rares exceptions d’absence totale d’activité onirique due à une lésion voire à une ablation d’un fragment du cerveau (à la suite d’un accident par exemple) ou à la prise de certains médicaments (des antidépresseurs), tout le monde rêve.
Si vous pensez que vous ne rêvez pas, c’est que vous ne vous souvenez tout simplement pas de vos rêves.
C’est un phénomène tout à fait normal car les rêves nous échappent le plus souvent. Ceux qui surviennent le plus aisément à la conscience sont ceux qui précèdent immédiatement le réveil.
La sensibilité et la faculté d’introspection permettraient tout de même de favoriser la remémoration onirique. C’est ce qui explique qu’en règle générale, les femmes se souviennent mieux du contenu de leurs rêves que les hommes.
Rassurez-vous Messieurs, tout est une question d’entraînement !
Oui, il est tout à fait possible d’entraîner la mémoire des rêves. Comment y parvenir ? En les racontant !
Dans certaines cultures, c’est même une tradition de raconter ses rêves depuis l’enfance, ce qui favorise leur rétention tout au long de la vie.
Par exemple, les Indiens d’Amérique ont souvent organisé leur société autour des rêves auxquels ils étaient très attentifs. Un évènement ne pouvait se produire que s’il avait été rêvé auparavant. Si vous leur demandiez de raconter leurs rêves, cela pouvait prendre près d’une heure…
Dans notre société, si vous demandez à quelqu’un de raconter son rêve, cela prendra quelques secondes tout au plus.
De plus, il est culturellement moins évident de dévoiler ses rêves. C’est un acte qui relève de l’intime et qui est peu habituel. Il peut même mettre mal à l’aise. Pourtant, c’est une activité que nous pouvons apprendre à développer et qui est riche d’enseignement au niveau personnel.
Les rêveurs lucides sont encore assez rares mais ils fascinent les neurobiologistes qui les invitent volontiers dans leurs laboratoires de sommeil afin d’en apprendre davantage sur le fonctionnement des rêves.
Dans les rêves lucides, qui peuvent être involontaires ou contrôlés, la personne est non seulement consciente qu’elle est en train de rêver, mais elle peut aussi y faire ce qu’elle veut !
Vous avez toujours souhaité voler, devenir une superstar ou avoir des pouvoirs surnaturels ? Les rêves lucides vous ouvrent toutes les portes !
Dans certaines cultures, ils ont été (et sont encore) pratiqués comme un art de vivre à part entière.
Le rêve lucide demande un certain entrainement, à l’exception de quelques rares cas particuliers de rêveurs qui ont la chance d’avoir cette lucidité de manière naturelle.
La bonne nouvelle est que l’on peut donc apprendre à maitriser nos rêves. Le contrôle absolu est certes plutôt rare, mais être simplement conscient que nous rêvons est déjà pas mal.
Lors d’une même nuit, nous pouvons passer d’un rêve lucide que nous contrôlons totalement, à un rêve lucide où nous avons moins de pouvoir, jusqu’à un rêve ordinaire. Il n’y a aucune règle en la matière.
Comment parvenir à faire un rêve lucide ? D’après mes recherches, il existe différentes méthodes mais elles sont toutes différentes et approximatives.
Parmi les techniques que j’ai pu trouver sur Internet, il suffirait d’y penser très fort afin d’imprimer profondément cette envie dans notre inconscient et de se concentrer sur le thème que nous avons choisi. Ensuite, il est conseillé de mémoriser un objet qui sera notre point de repère pour nous indiquer que nous rêvons (comme une toupille dans le film « Inception ») et d’être pleinement conscient de notre propre corps.
Si nous pouvons maitriser certains rêves, nous en souvenons-nous plus facilement que de nos rêves ordinaires ? Pas forcément. Les rêves lucides subissent le même traitement que les rêves ordinaires : ils peuvent être totalement oubliés ou laisser un vague souvenir au réveil.
Enfin, sachez que les enfants sont des maîtres en matière de rêves lucides !
Les rêves prémonitoires sont des rêves « jugés prophétiques, qui n’ont pas forcément de lien avec la vie privée du rêveur et annoncent un évènement futur censé se réaliser » (source Wikipédia).
Ils rapportent le plus souvent des évènements négatifs qui sont perçus beaucoup plus clairement que dans les rêves ordinaires. De plus, au réveil, leur souvenir est plus intense et vivace.
Comment s’expliquent-ils ?
La théorie la plus probable est liée à la fonction même du sommeil paradoxal : faire le tri entre toutes les informations que nous percevons et établir des catégorisations, des corrélations et des abstractions.
Plus les associations sont étranges, mieux c’est.
Ce travail nocturne effectué lorsque nous rêvons expliquerait l’accès à une forme de logique qui nous échapperait à l’état de veille. Bien plus encore, les rêves font des « plans » sur l’avenir et contiennent une forme de « pré-vision ». En ce sens, tous les rêves seraient prémonitoires.
Lorsque les rêves prémonitoires ne nous concernent pas personnellement, ils sont extrêmement intéressants car ils démontrent que les rêves ne sont pas toujours centrés sur nous et que nous pouvons rêver « pour » d’autres personnes, même très éloignées de nous.
Vous est-il déjà arrivé de rêver de l’un de vos proches disparu ? Si oui, vous avez fait ce que l’on appelle un « rêve visite ».
Pour ma part, cela m’est arrivé quelque fois et j’ai trouvé cela aussi fascinant que perturbant.
Une histoire troublante m’a été racontée un jour par un ami. Pendant la nuit, il avait rêvé de son voisin qui était venu lui rendre visite. Sa présence était si forte que mon ami a vraiment cru que cette personne était bien là avec lui dans son appartement. Le lendemain, il apprend une bien triste nouvelle : son voisin était décédé. Plutôt interpellant, vous ne trouvez pas ?
Il y aurait une explication rationnelle au rêve visite. Notre cerveau, marqué par l’émotion suscitée par la mort d’un proche, rêverait de ce proche afin d’alléger la charge émotionnelle liée à la mort. Cette analyse n’explique cependant pas l’histoire du rêve de mon ami…
Si nous souhaitons aller plus loin, et libre à chacun de croire en ce qu’il veut, nous pourrions percevoir les rêves comme un moyen d’accès à la spiritualité. Les vibrations que nous y dégageons seraient plus proches des défunts qui pourraient alors nous contacter plus facilement. Si vous vous souvenez du début de cet article, c’est en quelque sorte le fondement même du rêve depuis plus de 5000 ans.
Les théories freudiennes n’ont pas été prouvées scientifiquement, mais elles n’ont pas non plus été contredites.
Le rêve, en tant que messager de notre inconscient ou du moins de notre monde intérieur, reste encore très présent dans l’imaginaire collectif. Il existe par ailleurs une multitude d’ouvrages qui traitent de l’interprétation des rêves.
Vous souhaitez connaître quelques interprétations de rêves qui sont assez récurrents ?
Si vous rêvez par exemple de votre mort, c’est que vous cherchez à prendre un nouveau départ dans votre vie. Si vous conduisez dangereusement et que vous avez un accident de voiture, c’est que vous prenez des orientations hasardeuses voire dangereuses dans votre vie (en amour, au niveau professionnel, etc.). Si vous perdez vos cheveux en rêve, c’est un signe d’instabilité dans votre vie. Enfin, la perte des dents serait associée à des décès ou à une perte de vitalité due à un état de stress.
Tout cela est bien évidemment très subjectif et non validé scientifiquement. Si vous êtes néanmoins curieux, j’ai découvert le site https://wikireve.fr (dictionnaire encyclopédique d’interprétations des rêves). Il est propre à chacun d’adhérer ou non à ce type de méthode.
Sachez toutefois que la plupart de nos rêves sont assez « classiques ». Ils mélangent nos activités du quotidien, avec nos proches, à notre travail… Rien ne sert de chercher midi à quatorze heures pour la plupart d’entre eux. Les rêves marquants, qui sont de fait beaucoup plus mémorisés et communiqués, sont ceux qui ont inspiré le courant des interprétations oniriques, et qui de ce fait mériteraient qu’on s’y attarde, ne fut-ce que pour apprendre à mieux nous connaitre ou à identifier des vécus probablement anxiogènes ou douloureux.
De fait, selon Tobie Nathan, éminent ethnopsychiatre et professeur de psychologie qui tente de percer le secret des rêves depuis 40 ans, le rêve aurait une fonction de « reformatage » et de régénération, théorie qui est la plus répandue actuellement chez les neurophysiologistes et que j’ai détaillée plus haut. Le rêve commun du quotidien n’aurait alors nullement besoin d’interprétation. Il fait simplement son travail (recherche de solutions, création, etc.).
Concernant les rêves qui sont plus marquants et récurrents, ils peuvent être interprétés mais seulement par une tierce personne. A ce moment-là, le rêve aura servi à quelque chose.
Tobie Nathan cite par ailleurs un extrait du Talmud que j’aime beaucoup : « Un rêve qui n’est pas interprété est comme une lettre qui n’a pas été lue ». Dès lors, l’interprétation serait plus importante que le rêve lui-même. Il livre pour exemple le rêve très célèbre que César aurait fait : coucher avec sa propre mère. A la suite de cela, César serait allé chercher un interprète qui lui aurait dit que « sa mère c’est Rome et qu’il prendra Rome », ce qu’il a fait. Tobie Nathan fait cette remarque très humoristique que j’adore : « Imaginez s’il était tombé sur un lacanien… » (en référence à Lacan, célèbre psychanalyste).
Personnellement, je trouve ce professeur passionnant à tout point de vue, mais j’aime penser que nous pouvons également trouver nous-même un sens à nos rêves.
Si vous désirez en savoir plus, cliquez ici. Vous découvrirez sa conférence qui est très intéressante.
Et vous, de quoi rêvez-vous ?
Vous souvenez-vous de vos rêves ?
Pour vous faciliter leur remémoration, ne vous jetez pas sur votre téléphone au réveil. Prenez le temps de fermer les yeux et d’essayer de rattraper vos rêves dans un état de demi-sommeil. Dans un petit carnet que vous aurez laissé sur votre table de chevet, notez-y directement tout ce dont vous vous souvenez.
Vouloir analyser ses propres rêves, voire les partager avec son entourage, n’est pas une idée totalement vide de sens. Plongez dans sa dimension intérieure et tenter de la comprendre serait même bénéfique pour la santé mentale.
N’hésitez pas à me laisser votre avis et à partager votre expérience en commentaires.
Merci de partager cet article aux autres rêveurs. Cela m’aidera beaucoup à faire connaitre mon blog !
Prenez soin de votre sommeil, il prendra soin de vous.
Caroline
Commentaires récents